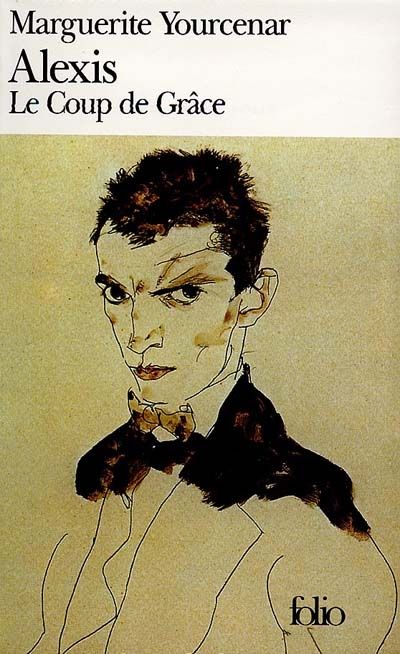Au fond, le bruit de l’autoroute. Le bruit de l’autoroute, nuit et jour, le bruit de l’autoroute.
Et à la minute, plus rien, plus de bruit d’autoroute, plus rien.
Silence. Le silence.
À la minute, le vrai bruit du vent. Le vrai chant des arbres.
À la minute, la chorale des mésanges, le battement de cœur des papillons.
À la minute, des enfants dans la rue.
Là-haut, le ciel zebré de rails de ouate des avions. Le ciel toujours zebré, barré, balafré.
Et à la minute, le bleu, le bleu, rien que le bleu.
À la minute, peau de ciel cicatrisée.
Et la chorale des mésanges et les enfants dans la rue.
Au petit matin, les travailleurs de l’aube tristes et bossus.
Tristes et bossus dans leur voiture.
Et sur les quais : des amas de travailleurs tristes et bossus.
Pendus par la cravate ; ecchymoses de bleu de travail.
Et à la minute, plus de voiture, plus de quais ;
Les cravates sous le lit, dans le linge sale le bleu de travail.
À la minute, des humains. Des vrais humains. Des humains qui respirent. Des humains avec des jambes, avec des dents, avec un cœur.
À la minute, des gens dans leur jardin. Des gens aux balcons.
Et dans la rue, à la minute, des canards, des renards et du soleil en étincelles.
A la minute, de l’air, du silence, du vert, du vivant,
La chorale des mésanges et des enfants dans la rue.
Ce matin-là, mon agenda, minuté, des devoirs, des achats, des embouteillages, une conférence, un rendez-vous professionnel, une visite, des achats encore, et encore des embouteillages et des devoirs. Et des achats.
Et à la minute, les mots de mon agenda sur le sol et je les regarde, je n’y crois pas, je n’y crois pas.
Je saute, je danse, je piétine les mots étalés sur le sol.
À la minute, je piétine mon agenda. Je saute, je danse, je déchire mon agenda.
À la minute, dans l’herbe je m’allonge, revenue à l’état originel de l’enfant qui n’est obligée de rien.
A la minute la liberté.
À la minute de l’air, du silence, du vert, du vivant, la chorale des mésanges, le battement de cœur des papillons et dans la rue, la vraie vie.
Texte paru dans AURA 111, hiver 2021-2022. Thème : Confinement.